Il est loin le temps des démonstrations au «pistolet à air» acheté de leurs deniers par ceux qui allaient devenir célèbres dans le monde entier : quel chemin parcouru ! Que de joies, que de peines. A travers cette occasion qui m’est donnée de me retourner sur cette aventure, je voudrais m’adresser à ceux qui m’ont accompagné durant ces années passionnantes : «qu’aurais-je fait sans vous ?»
A force de parler du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (G.I.G.N.) aux autres, nous n’en avons plus parlé ensemble. Pour les jeunes du Groupe que je connais à peine, pour ceux que je ne connais pas, pour ceux qui un jour seront dans cette unité, je voudrais évoquer en quelques pages l’histoire de la création du G.I.G.N., la vraie, celle écrite par vos anciens !
15ème anniversaire du GIGN
LES CONSÉQUENCES INATTENDUES D’UN PSYCHODRAME
Les manifestations de LIP battent leur plein, nous sommes à la fin d’août 1973… Un télégramme me rappelle à Paris et j’abandonne mon unité : il va m’être confié une mission importante ? Je ne sais pas trop laquelle mais le terrorisme inquiète les autorités… Munich, un an plus tôt, a traumatisé l’opinion publique. Instructeur à la formation des équipes commandos, j’ai eu l’occasion de préparer et conduire plusieurs simulations sur les problèmes de forcenés et de prises d’otages. J’avais également dit ce que je pensais sur le manque de moyens de la Gendarmerie face à ces problèmes. A l’occasion d’un de ces exercices, j’avais monté un psychodrame pour recréer au plus juste la situation, tentant de faire prévaloir la partie négociation et psychologie plus que l’aspect purement technique.
Cette manière peu orthodoxe de gérer l’événement, l’action se calquant sur l’évolution dramatique de la situation, avait impressionné le Capitaine Baux Jean-Pierre, qui était à cette époque le responsable de cette instruction particulière des escadrons de Gendarmerie. Cette formation d’une «élite» au sein d’unités traditionnelles de maintien de l’ordre, nécessitée par une période sociale particulièrement agitée où la Gendarmerie avait souffert, était en soi le terreau d’où germera le G.I.G.N. Plus que la manière qui était calquée sur des méthodes strictement militaires, qui ne ressemblaient en rien à ce qui fera l’originalité du Groupe, c’est l’esprit qui changeait tout : dégager une élite entraînée et motivée.
Baux, bel officier issu de Saint Cyr, grand, solide, possédant un charisme certain, sera secondé avant son départ par le Capitaine Gervais, Saint Cyrien également, avec lequel j’avais fait Melun. Le Général Héraut, commandant la 1ère Région Militaire, voulait un groupe anti-preneurs d’otages. Il demande à Baux qui, à son poste voyait passer tous les jeunes officiers de la région, de lui donner un nom pour créer cette nouvelle unité. Nous en parlerons ensemble plus tard, et il me dit que, sans hésiter, il donna le mien : je lui dois ma carrière et la Gendarmerie le G.I.G.N, sa plus belle unité. Sans des hommes comme lui, on passe à côté de ce qui change vraiment l’histoire. Pourtant la Gendarmerie le traitera, comme à son habitude, «comme les autres» et quelques dix années plus tard, il quittera l’Arme pour le secteur civil, qui se réjouira de l’avoir recruté. La Gendarmerie elle, n’a rien fait pour le retenir et a perdu un généralisable de talent : dommage ! Son cas n’est malheureusement pas isolé.
J’étais Lieutenant à l’escadron de Saint-Denis, jeune marié, jeune papa, je faisais tout ce qu’il était possible pour éviter les services statiques : cross, courses orientation, stages divers, instructions commando, tout était bon pour éviter la longue attente déprimante dans les cars. La vie d’escadron est sympathique, mais on en fait vite le tour et la seule chose vraiment passionnante est l’instruction du personnel. C’est généralement dévolu au dernier arrivé, ce qui était mon cas. De toutes les façons, nous n’étions que deux : le Lieutenant Mottin et moi. C’était un officier issu du rang, un de ces hommes rudes, parti de ses montagnes très jeune et auquel l’Armée puis la Gendarmerie apporteront tout. Passé par tous les échelons de la carrière, il savait beaucoup de choses et son contact m’a éclairé sur un univers que j e pensais connaître : les hommes… Quelques années plus tard, le G.I.G.N. étant réputé dans le monde entier, non sans fierté il dira : «Prouteau, c’est moi qui l’ai formé… », c’est un peu
Dès mon retour à Paris, ayant laissé derrière moi le bruit de LIP en fureur, on me demande si je suis volontaire pour créer cette entité un peu spéciale : 29 ans, la foi qui déplace les montagnes, j’ai du mal à réaliser ce qu’il m’arrive, tout s’est passé si vite… Muté à Maisons-Alfort dans l’escadron du Capitaine Gervais, un message faisant appel aux volontaires de la 1ère Région Militaire, mon premier travail est la sélection de la première équipe. 17 : c’est le chiffre qu’il restera de la trentaine de candidats à l’aventure ne sachant pas trop où ils allaient. La plupart me connaissaient en tant qu’instructeur commando et mon côté atypique : cheveux un peu longs, pantalons pattes d’éléphant et … ma guitare. A ce sujet, l’un de ceux qui a contribué à écrire les plus belles pages du Groupe, Pierre R…, me racontait que, ne me situant pas très bien, un de ses amis lui dit «mais tu sais Prouteau, celui qui «gratte» la guitare…
Dès que l’occasion lui en était donnée, Christian Prouteau s’entrainait au tir.
LE RESPECT DE LA VIE
Quelques jours avant la sélection, je reçois un coup de téléphone angoissé d’un candidat que j’appréciais beaucoup : le Chef Lepouzé – «Mon Lieutenant, ils ne veulent pas accepter ma candidature, ils me trouvent trop vieux … Faites quelque chose, je veux absolument venir avec vous !» Ce fut ma première démarche pour forcer une décision. Il y en aura beaucoup d’autres mais celle-là a compté pour le G.I.G.N. : Lepouzé, Claude, pour nous tous, sera le sage des sages et pour moi l’adjoint des jours les plus incertains. Paul Barril ne nous rejoindra que beaucoup plus tard alors que tout sera acquis. Ces choix qui tiennent à si peu me forgeront une conviction : « Il n’y a pas de hasard…»
Mai 1981, de gauche à droite: lieutenant Philippe Masselin, capitaine Paul Barril, capitaine Christian Prouteau, lieutenant Claude Lepouzé
Ensuite tout s’enchaînera très vite. L’entraînement a occupé nos vies. Rien de ce qui existait ne correspondait à la mission et une nouvelle technique a vu le jour. Tout était fondé sur une obsession «libérer les otages», si possible en épargnant les agresseurs. Autour de nous, aucun exemple, aucune expérience, rien nous permettant de copier ou d’améliorer. Tous les pays, ayant tenté d’agir contre des prises d’otages, avaient utilisé des unités de type commando, en particulier les Israéliens. A la fois pour des raisons d’éthique et pour des raisons d’efficacité, j’ai privilégié l’intervention graduée :
– Négociation
– Neutralisation.
Une opération ratée aurait été, sans aucun doute à l’époque et dans le contexte, la fin de l’expérience.
La phase de négociation est capitale : elle permet de durer et parfois de gagner ; rien n’est plus beau que d’obtenir une reddition – c’est l’exercice parfait où l’esprit l’emporte sur la force vive, c’est aussi le respect de l’autre, quelles que soient les circonstances – Mais en fait, elle est aussi indispensable pour prévoir l’action, car chaque situation est unique de par ses acteurs et de par le lieu où elle se déroule. Il fallait parer au plus pressé et l’intervention était malheureusement la priorité des priorités : dégager une préparation , qui permette à tous les hommes d’agir dans n’importe quel milieu, avec les moyens de mettre en évidence un précepte qui allait devenir notre credo : le respect de la vie. Cela m’engageait très loin, car c’est le résultat que l’on veut obtenir qui définit les moyens – en l’occurrence nous n’avions rien et nous n’étions rien…
Il fallait prouver et vite – Créé le 3 novembre 1973, le futur G.I.G.N., d’abord appelé Équipe Commando Régionale d’Intervention (E.C.R.I.), devait être opérationnel le 1er mars 1974 : une vraie gageure ! Sans rentrer dans une analyse poussée de l’intervention, il faut savoir, pour comprendre pourquoi nous avons développé cet entraînement si spécifique à cette unité, comment se découpe une opération en dehors de la négociation :
– Préparation
– Approche
– Action.
La préparation incombe au responsable. G ‘est long et angoissant, car au bout il y a la confrontation inévitable avec l’engagement des hommes. Tenter de voir tout, de comprendre, prendre la décision d’agir après avoir construit un plan d’action, convaincre les autorités, est une tâche lourde. Mais quelles que soient les certitudes de celui qui commande, c’est la qualité de la formation des hommes qui permettra le succès. Il fallait que l’unité soit, dans sa composition, d’une grande souplesse pour s’adapter à l’événement et non plaquer des schémas tout faits.
Remise de la médaille de la Gendarmerie à un homme du G.I.G.N., ici, aux côtés du Capitaine Chesneau et du Préfet Prouteau.
COMMENT ENTRER DANS UN IMMEUBLE EN ÉVITANT LA PORTE…
L’approche ne doit pas être un obstacle et chaque homme doit être capable de se déplacer dans tous les milieux (terre, air, mer). L’action doit être très précise dans ses aspects techniques offensifs pour obtenir le résultat souhaité.
C’est ce qui conduira le Groupe à évoluer et s’entraîner comme personne ne l’avait fait avant lui et sa manière de travailler sera copiée par toutes les unités du monde dès 1975. La base du travail est la mise à niveau physique, la préparation intensive devant apporter aux hommes la résistance, les opérations pouvant durer longtemps sans relève. Lors de la sélection, le niveau physique était nettement moins élevé que ce qui est exigé actuellement, mais rapidement il atteindra des sommets. Il était demandé en particulier une épreuve de natation de vingt-cinq mètres. Un garçon, qui voulait absolument être admis, Robert A…, mais qui nageait comme une «clé à molette» me demanda : «Mon Lieutenant, les vingt-cinq mètres c’est en surface qu’il faut les faire ?… » Interloqué, je répondis que l’essentiel était de parcourir les vingt-cinq mètres. C’est ainsi qu’il effectua l’épreuve… sous l’eau, ne sachant pas nager ! Cette volonté, ce courage étaient indispensables à la future unité ; il intégra le Groupe, où il figurera parmi les meilleurs.
La formation physique est la base ; c’est ensuite que tout commence. La plupart des problèmes, auxquels nous risquions d’être confrontés, se dérouleraient dans les lieux les plus divers : immeubles, avions, bateaux. Dans ces trois cas, les évolutions dans le cadre de l’approche risquaient d’être aériennes, l’accoutumance au vide était donc indispensable. Pour cet entraînement, la sélection doit faire apparaître les tendances au vertige, qui peut être un handicap insurmontable. C’est ainsi que le Groupe développera, à partir des techniques d’escalade traditionnelles, une méthode d’approche tout à fait nouvelle adaptée aux édifices, mais aussi une utilisation peu conventionnelle de l’hélicoptère :
– approche par escalade naturelle
– approche avec hélicoptère
– par rappel- par dépose
– par corde lisse
La Gendarmerie logeant les familles, les immeubles des casernes furent utilisés pour les exercices pour la plus grande joie, le mercredi, des enfants. Maisons-Alfort, cantonnement du G.I.G.N. jusqu’en juillet 1982, possède une tour de cinquante mètres de haut. Elle sera pendant toutes ces années l’épreuve ultime redoutée par les jeunes : treize étages qu’il fallait escalader à mains nues par les balcons, sans assurance (1). Très vite, la technique évoluant, les cinquante mètres étaient gravis en des temps record: moins d’une minute pour les meilleurs, en particulier Jean-Paul V… Je dus, pour éviter le pire, interdire les concours…
Un autre exercice plus redouté que tout, mais à la portée uniquement de quelques-uns, était l’escalade par les fenêtres ; une sorte de main à main terrible qui, lors d’une présentation devant le Directeur d’alors, Monsieur Cochard, le fit se retourner en se cachant les yeux en disant : «Non, je ne veux pas voir cela… » Je reviendrai sur ce Directeur, auquel le G.I.G.N. doit beaucoup.
Les deux spécialistes de cet exercice périlleux étaient Jacques D… et Pierre R… Il y avait aussi les pénétrations en balancier, permettant d’entrer dans une pièce, en partant en rappel deux étages au-dessus et de tirer sur des cibles après avoir percuté et fait voler en éclats la fenêtre. Ce fut une époque fertile, où l’imagination était au service de l’efficacité : pour les autres, il suffira ensuite de copier, en oubliant un peu trop vite pour certains de respecter ceux auxquels ils doivent leur identité. L’hélicoptère sera notre outil de travail le plus original. Ce que nous avons réalisé avec les équipages, modifiera la vision de ce moyen magique de transport. Nombreux sont les films d’aventure, qui ensuite l’utiliseront autrement… Belmondo ne fut pas le dernier et j’évoquerai quelques bons moments que le G.I.G.N. a passés auprès de cette vedette sympathique.
Le troisième axe d’effort, après l’entraînement physique et l’approche, était l’intervention à mains nues. Psychologiquement, il était important de dégager le personnel au contact de la crainte du corps à corps. Sans cette préparation, l’arme serait devenue très rapidement le prolongement du courage, ce que je voulais éviter à tout prix. Pratiquant le judo depuis l’âge de douze ans et l’ayant enseigné plusieurs années, j’ai commencé l’entraînement par ce sport de combat. Les réflexes sont développés, l’esprit apprend à anticiper et la crainte de l’adversaire est maîtrisée. Le judo n’est malgré tout qu’une discipline académique et avec l’aide de Norbert J…, un excellent judoka et karatéka, nous avons développé une technique appropriée à notre mission : esquiver un coup de poing, désarmer un agresseur (couteau, revolver ou fusil), le neutraliser sans brutalité. Avec quelques rudiments de boxe, le mélange de ces sports de combat donnera un résultat très spectaculaire dans les démonstrations, qui se succéderont dès le début de 1974 à une cadence effrénée. La difficulté est de donner aux hommes un atout qui, bien sûr ne peut être une discipline unique, mais la synthèse de plusieurs.
Vouloir faire des judokas, des karatékas, des boxeurs confirmés avec des titres n’aurait servi à rien. Pourtant, la tentation est grande ; la course aux brevets impressionne plus, même si elle n’est pas utile en opération. Paul Barril (2), quelques années plus tard, cédera un peu à cette tentation et responsable de l’entraînement aux sports de combat il engagera le personnel dans une formation de full contact qui, après lui, passera d’un moyen à une fin en soi. Cette erreur sera commise par d’autres officiers du G.I.G.N. dans d’autres disciplines, en particulier le parachutisme. Le travail des premières années, simple et efficace, n’avait qu’un but : l’action. La partie présentation permet de faire découvrir la qualité du produit, mais ne doit pas être autre chose, pour ceux qui l’exécutent, qu’un exercice de style.
TIRER BEAUCOUP A L’ENTRAINEMENT POUR NE PAS AVOIR A TIRER EN OPÉRATION
Maîtriser n’ayant pas suffit, il faut envisager l’utilisation des armes. C’est dans ce domaine en particulier que le G.I.G.N. restera un modèle. Aucune unité au monde n’a abordé sa mission avec autant de principes. Nous appartenons à une Arme singulière, la Gendarmerie, dont la réputation de sang-froid et de sérénité a contribué à son renom. Les liens étroits, qu’elle entretient avec la population depuis plusieurs siècles, font que son personnel a un comportement différent et le G.I.G.N. ne pouvait pas être différent. Je voulais faire rapidement de mon Groupe le meilleur dans le domaine du tir sélectif. Bon tireur presque naturellement, j’avais identifié, lorsque j’étais instructeur, les points qui sont essentiels pour acquérir rapidement une bonne technique. Cette réflexion mérite à elle seule un livre. Le tir est un sport très pratiqué et une discipline militaire importante en théorie.
La rituelle séance de dédicaces
Pour l’Armée, je serai un peu dur, mais je conserve de cette instruction le souvenir d’une corvée. Il faut apprendre à beaucoup les rudiments du tir sans avoir d’accident. C’est ce qui m’a fait souvent dire que dans l’Armée on aime l’armement… enchaîné à l’armurerie ! Adorant le tir depuis mon plus jeune âge (j’ai grandi en Corse où les armes à feu sont vénérées), je pensais trouver à travers mon choix de la carrière militaire ce plaisir en plus… Las! les cartouches sont rares et ceux qui aiment ce sport sont un peu pris pour des maniaques. Au 41ème Régiment de Transmissions, où je me suis retrouvé comme sous-lieutenant, j’avais fait dans un bâtiment, au toit effondré, à l’intérieur de la caserne, mon premier stand de tir à l’arme de poing, non homologué, tout cela avec la complicité du Colonel d’Anselme, commandant le régiment : un homme extraordinaire, qui suivait ce que je faisais avec bienveillance, même si ce n’était pas conforme aux habitudes, voire au règlement.
Apprendre à tirer, choisir les bons outils : c’était l’ordre de priorité. Notre premier pistolet fut le MAC 50 et le 49/56 pour le fusil. Ils n’étaient pas sélectionnés, mais en fait le seul vrai problème était d’avoir des munitions. Je ne raconterai pas comment j’ai pu dépasser les dotations qui nous étaient allouées à l’époque. Mais, il n’a pas été simple de convaincre certains qu’il faut beaucoup tirer de cartouches pour former un tireur d’élite. Malgré ces débuts difficiles, qui aujourd’hui semblent impossibles, rien ne nous aurait arrêté et n’atteignait notre volonté : l’avenir était à nous et nous étions persuadés de réussir ; cela frisait l’inconscience. Mais d’avoir gagné peu à peu ce qui était indispensable à l’exécution de notre mission nous forgea une ténacité à toute épreuve. Le Directeur, Monsieur Coehard, disait souvent en souriant : «Prouteau, si vous lui fermez la porte, il rentre par la fenêtre…», suivi d’un grand sourire, allusion en forme de boutade à nos méthodes de travail…
Mondésir, petit lieu-dit au sud d’Étampes, ancienne base d’aviation qui vit évoluer ce qui deviendra la Patrouille de France, fut notre camp d’entraînement. Tout y était possible et le site isolé nous permettait de faire beaucoup de bruit, ce qui est indispensable pour approcher la réalité. C’est là que le Général Héraut, satisfait des progrès que nous avions faits, souhaita présenter «son unité» au Directeur. Il n’était pas question de montrer que nous tirions en dehors d’un «stand homologué». La pénurie de cartouches étant réelle, j’avais demandé au personnel d’acheter, pour pouvoir progresser, des pistolets à air comprimé. J’avais trouvé chez un fabricant de jouets un pistolet bon marché, réplique d’un modèle réputé, mais trois fois moins cher. Aussi est-ce avec ces pistolets que les démonstrations de tir «en situation» ont été faites devant Monsieur Coehard. Les résultats étaient parfaits, mais l’effet désastreux : le «pif» de ces armes étant un peu ridicule. Le Directeur se retourna vers le Général et lui dit : «Il faudra quand même leur donner de vrais pistolets… » L’effet fut immédiat, les armes suivantes étaient neuves et sélectionnées pour leur précision. Parallèlement, nous étions autorisés à rechercher le modèle le plus approprié pour notre mission. Le tir est le recours ultime et il ne peut y avoir d’approximation.
Le vocabulaire lui-même a son importance. En fait, la plupart du temps, tirer rime avec tuer et malheureusement c’est souvent vrai. Or, le but du G.I.G.N. était : délivrer les otages et remettre leurs agresseurs à la justice. L’emploi du feu ne peut être dans cet esprit que la neutralisation. Bien sûr, certaines circonstances pouvaient exiger que ce terme puisse avoir un sens définitif, mais dans la démarche ce doit être le choix ultime : toute la préparation sera donc d’obtenir des tireurs une précision redoutable, quelles que soient les conditions du tir, d’abord avec un fusil, ensuite avec une arme de poing.
C’est avec le premier que les résultats sont les plus rapides. Le second est assez ingrat et il y a peu de tirs de précision, en dehors des clubs ou des concours, faits avec un pistolet ou un revolver. De plus, c’est souvent avec des munitions sous-chargées peu éloignées dans leurs effets du «pif» de nos pistolets à air. Les exercices de tirs dans les différents corps armés sont souvent dits de précision et instinctifs. C’est ce dernier mot que j’ai cherché à proscrire. Dans les opérations que nous avions à faire, le tir ne pouvait être que de défense ou offensif.
Le tir «instinctif», comme son nom l’indique, est un tir réflexe dangereux dans une situation confinée, où les otages côtoient leurs agresseurs. Le principe incontournable, dès qu’il y a action, est l’utilisation limitée des armes : un coup de feu, un objectif touché. C’est pour cela que j’ai abandonné, dès que je l’ai pu, le pistolet au profit du revolver. Des choix récents ont conduit la Gendarmerie à choisir un pistolet automatique à grande capacité de magasin (quinze coups). Ces armes ont une cadence de tir trop rapide et ne devraient pas équiper, comme les pistolets mitrailleurs, les forces de Police.
De plus, les situations dans lesquelles elles risquent de se retrouver, nécessitant l’utilisation des armes, sont rares pour ne pas dire exceptionnelles et au-delà de deux ou trois coups de feu tirés, il y a un vrai problème… Les balles, qui ne touchent pas leur but en milieu urbain, ont toutes les «chances» d’en trouver un qui soit innocent… Cette discipline deviendra l’un des points forts du G.I.G.N. : «tirer beaucoup, pour ne pas avoir à tirer en opération», principe paradoxal pour le moins, qui était répété aux hommes inlassablement.
Le feu appelle le feu : ceux, qui ont vécu des événements comme l’Algérie ou plus simplement une arrestation qui tourne mal, le savent. J’ai en mémoire des situations récentes, où les leçons du passé n’ont pas été retenues. Pour nous, il fallait montrer nos qualités de tireur… au stand ! Pour le reste, le tir à l’arme de poing ne sera, les premiers temps, malgré la préparation intense, qu’un moyen défensif. Il ne deviendra offensif, c’est-à-dire toucher un endroit précis comme au fusil à lunette, que plus tard avec l’arrivée du Manurhin MR 73 en 357 Magnum. Encore fallait-il un stand de tir pour s’entraîner… Nous étions obligés de faire le tour de la Région Parisienne pour trouver des stands libres : Montlhéry, Melun, Meaux, etc…, tout ce qui existe pour tirer nous a vu passer. S’il est possible de s’entraîner au fusil et d’atteindre un bon niveau avec une séance par semaine, cela est impossible à l’arme de poing. Obtenir le même résultat nécessite un travail de tous les jours. Je me lançais donc dans la construction d’un stand (non homologué). Les douves du Fort de Charenton jouxtaient nos locaux. Dans un angle, un tas de terre servait aux armuriers du «corps» pour tester les armes qu’ils réparaient. Quelques mots sur ces spécialistes, qui nous ont aidé à améliorer nos armes pour atteindre la perfection. Il existera entre eux et nous une véritable complicité, comme en course entre le pilote et son mécanicien, avec l’amour des belles armes en plus… Leur chef, l’Adjudant H…, impressionnera les ingénieurs de la Manurhin. Ils avaient leur atelier touchant nos locaux, ce qui facilitera les choses. Ils ont été, j’en suis sûr, les premiers à croire en nous. J’ai développé avec eux et un de mes anciens de l’Escadron de Saint-Denis, Christian L…, une arme exceptionnelle : le revolver à lunette avec bipied, capable des mêmes performances qu’un fusil jusqu’à cent mètres, avec la discrétion en plus…
La construction du stand de tir nous occupera beaucoup. Tous les corps de métier existant dans ma petite équipe, je fis les plans et nous réalisâmes, en un temps record, un splendide (pour nous) stand, tout en matériaux de récupération, où se dérouleront toutes les démonstrations de tir du Groupe jusqu’à notre départ pour Satory en 1982. Cet endroit était magique : nous y travaillions, mais aussi nous nous y détendions. Les traditionnelles brochettes du samedi à 11 heures, à la fin du dernier entraînement de la semaine, étaient le moment où tout le monde se retrouvait. Ce stand a fait couler beaucoup d’encre, y compris la ciblerie construite elle aussi par nous. Je manquais de terre pour mettre à niveau les 300m2 du futur terrain de tir. Il y avait beaucoup de travaux dans cette région et des norias de camions-bennes passant sur la nationale. Nous eûmes l’idée de les détourner, les déblais qu’ils transportaient allant vers une quelconque décharge. Il nous en fallait 100ni3, ce qui était en fait par ce moyen assez peu. Pour le béton ce fut un peu plus difficile, mais les «toupies» ne sont pas toujours vides…
Trois mois plus tard, le stand était fini, il n’avait rien coûté à l’État et nous étions fiers de notre réalisation : il était à nous, parce que nous l’avions fait. Jusqu’en 1982, il y sera tiré environ 1000 000 de cartouches : non homologué, mais indispensable et toléré. Le règlement n’a pas toujours ce côté systématique que certains lui voudraient. Un jour malgré tout, sous la pression des «ragnagnas», le Général Rigaud fit suspendre les exercices de tir, une hypothétique commission du Génie voulant statuer sur l’avenir du stand. J’attendis patiemment une semaine et ensuite fis un rapport expliquant que je ne pouvais plus assurer l’efficacité de mes hommes et qu’il n’était pas question qu’ils partent en intervention s’ils ne reprenaient pas l’entraînement quotidien au tir. Le résultat dépassa mes espérances : j’eus un «4PO» (forme écrite et officielle de remontrance à l’encontre d’un officier de Gendarmerie), dans lequel le Général reprochait à mon rapport son «ton comminatoire ».
… Mais le stand fut ouvert le lendemain. Rigaud fut un grand Général pour la Gendarmerie. Il a aussi beaucoup aidé le G.I.G.N. Un livre suffirait à peine pour parler de cette seule discipline. Le tir au revolver de gros calibre est quelque chose de passionnant. Nous avons élevé l’utilisation opérationnelle du 357 Magnum, que ce soit dans l’évolution des armes, des munitions, de la technique, à des niveaux jamais atteints. Tout était possible après et tout a été fait, y compris l’incroyable : des otages libérés par action de tireurs d’élite au revolver. Aucune autre unité au monde ne l’avait fait délibérément et ne Fa fait depuis. Le tir au fusil était le moyen fondamental d’intervention du moins au début. La technique étant ce qu’elle était à l’époque, c’est-à-dire inexistante, il n’y avait pas beaucoup de solutions :
– Négociation – reddition
– Neutralisation à mains nues
– Neutralisation par arme à feu
Les deux premières sont réalisables face à un ou deux individus hors contexte politique, mais dans le cadre du terrorisme c’est moins évident. Aussi, s’il ne peut y avoir de négociation et que l’événement doit cesser, le seul recours devenait à cette époque le tir au fusil. Le drame de Munich en avait apporté la preuve. C’est à partir de cet échec (juillet 1972) que la réflexion sur la technique d’intervention contre les prises d’otages débutera. J’ai pu étudier soigneusement cette affaire à l’époque, les documents d’enquête officiels ayant été publiés dans un livre. Tout ce qu’il ne faut pas faire y est : mauvaises communications, mauvais renseignements, manque de coordination, personnel non préparé, etc… Plusieurs choses m ‘ avaient frappé lorsque j’ai analysé cette opération, mais plus particulièrement l’utilisation «des tireurs d’élite», qui était un modèle de loupé.
Tout d’abord sur le choix de l’équipement, le fusil d’assaut même équipé d’une lunette n’ est pas une arme de précision, mais surtout le nombre de tireurs d’élite (quatre) pour le nombre de terroristes (huit). Il y avait là une erreur d’appréciation que je n’ai pu élucider, même après avoir rencontré longtemps après le responsable de cette opération. Également, j’étais persuadé que le début de l’action, à partir du moment où il était perçu par les terroristes, ne devait pas leur permettre de réagir, donc être très très court. La phase d’action pour Munich a duré près de deux heures et ils ne se sont retournés contre leurs otages que lorsqu’ils ont eu la certitude qu’ils ne pouvaient plus s’en tirer, soit près d’une heure après l’intervention des chars. Il ne s’agissait plus d’une opération de libération d’otages, mais d’un assaut militaire. Cette étude était riche d’enseignements. Sans l’échec de Munich, rien n’aurait été possible. On apprend plus dans ce qui n’a pas fonctionné que dans ce qui a réussi.
Le tir au fusil devait donc permettre de neutraliser dans la même seconde plusieurs preneurs d’otages, situés loin, se protégeant derrière des innocents. C’est cette équation, ressemblant assez à la quadrature du cercle, qui a conduit à mettre sur pied le «tir simultané». Toutes les unités du monde effectuent, avec des méthodes plus ou moins sophistiquées, ce type d’entraînement. Seul, le G.I.G.N. est intervenu deux fois avec succès dans ce cas de figure, le plus difficile qui existe.
Passer du tir de précision au tir commandé n’est pas évident. C’est une école de maîtrise, où les nerfs sont mis à rude épreuve. L’attente peut durer des heures et l’instant favorable quelques secondes. Il faut à ce moment précis que tous les tireurs soient prêts et au déclenchement du tir, 1′ on n’entende qu’une seule déflagration. C’est ce qui a été fait à Djibouti pour libérer un car de trente enfants pris en otage par huit terroristes par 50°, quelque part sous le soleil à la frontière somalienne, en plein désert à Loyoda ! Ce nom résonne toujours dans nos têtes et cette opération, considérée comme exemplaire, nous laisse toujours une impression amère : nous avons réussi ce qui semblait impossible, mais pas complètement… Bientôt quinze ans, c’était le 4 février 1976 à 15h45.
«PORTEZ LE HAUT, SOYEZ EN FIER !»
A partir de ce jour-là, beaucoup de choses ont changé. Il avait été créé une deuxième unité du type G.I.G.N. à l’escadron parachutiste de Mont de Marsan. Travaillant sur une technique différente plus proche de l’action commando, elle fut dissoute à cette époque. Les volontaires la constituant ont pu rejoindre le G.I.G.N. Nous avions imposé toute la recherche opérationnelle et le choix des équipements, ce qui évitait de créer un déséquilibre. Ils nous apportèrent beaucoup, surtout en milieu subaquatique avec des garçons comme Jacques H…, Charley J…, Gérard B… et la mise à niveau pour les nouveaux arrivés fut très rapide.
C’est à cette époque que j’ai obtenu que l’unité soit parachutiste. L’insigne, que j’avais dessiné avec Daniel D.. .et qui ornait nos manches, fut transformé et le réticule de visée, le mousqueton de montagne et la grenade furent rehaussés d’un parachute. Il devint un brevet rond, numéroté et fit l’objet d’une remise officielle très solennelle. Le Colonel Beaudonnet, notre «vieux soldat», l’officier le plus décoré de la Gendarmerie, accepta d’être notre parrain. Malgré nos côtés atypiques, il nous aimait et nous a beaucoup soutenus. Je pris l’habitude de conserver, à la remise des armes et des brevets, ce côté militaire rigide, qui confère à ces cérémonies toute l’émotion indispensable pour un tel engagement : accepter de risquer sa vie pour en sauver d’autres… Dans un contexte plutôt tourné vers la facilité, la démarche était assez exceptionnelle pour être soulignée.
C’est ainsi que nous avons petit à petit fait naître les traditions du G.I.G.N. «Gendarme X…, je vous remets le Brevet N°… Portez le haut, soyez en fier !»
Phrase initiatique, attendue par ceux qui, pendant huit mois, se dépasseront pour être dignes des anciens. C’est autour d’une symbolique comme celle-là, en plus de l’entraînement et des interventions, que le G.I.G.N. a forgé son âme, avec ses disparus en plus…
Mais, avant de parcourir tout ce chemin, d’arriver à la maturité, il a fallu se faire connaître. Ce fut la grande époque des démonstrations itinérantes. Une idée du Général Héraut, pour présenter aux autorités administratives et judiciaires, une unité spécialisée entraînée qu’il fallait utiliser. Une grande école également, car les lieux étaient différents et il fallait s’adapter à chaque site de démonstration. Sans ce «barnum circus» de l’intervention, nous aurions eu du mal à obtenir ces immeubles, tous différents pour nous entraîner. Là on nous les proposait : «mon Lieutenant, cette tour vous convient ?» Nous avons ainsi appris à évoluer n’importe où. C’est ainsi que la presse a découvert le G.I.G.N., avant ses succès les plus marquants.
Ce qui impressionnait le plus, c’était les évolutions à partir de l’hélicoptère. L’approche en rappel est assez spectaculaire. Le principe en est simple et nous avons été les premiers (encore) à l’utiliser pour déposer des hommes sur des surfaces réduites. J’arriverai à faire assimiler chaque descente à un saut en parachute, ce qui comptera pour leur avenir ; utiliser les hommes est une chose, leur garantir la fin du parcours est indispensable. Cette technique est particulièrement délicate. Le descendeur possède une veste renforcée sur l’épaule, là où la corde glisse pendant l’exercice. L’échauffement, compte tenu de la vitesse, est très important et peut provoquer, s’il n’y a pas de protection, de graves brûlures. La main, munie d’un gant, guide la corde et suivant qu’elle se trouve en avant ou en arrière, régule la vitesse de descente en augmentant ou diminuant le frottement. L’altitude de dépose était pour les plus grandes hauteurs de 120 m. Là aussi, il fallut éviter la course au record, les meilleurs descendeurs faisant environ 10 m/s et il n’y a pas de ventral comme en parachute. Étienne L.., le meilleur de nous tous sur cet exercice, mettait moins de dix secondes pour les 120m. Au freinage, la corde s’allonge d’environ 15m, ce qui nécessite une sérieuse anticipation. La cadence de descente, toujours à 120m, était d’environ 1 ’30 pour une équipe de quatre hommes.
La télévision s’était intéressée à nous et un jour, Henri Verneuil, demanda le concours du G.I.G.N. pour tourner un film avec Belmondo : « Peur sur la ville». Le clou était l’intervention de «Bebel» avec le G.I.G.N. dans une prise d’otages sur une tour de 100m de haut en front de Seine : la tour Keller, à côté de la Tour Eiffel. L’hélicoptère Gendarmerie, deux hélicoptères pour filmer et tout cela en 35mm. Nous avons déployé tout notre matériel pour le tournage, fait des rappels sur les trente étages, histoire de s’entraîner pour les «pénétrations en balancier», mais Verneuil me dit «nous ferons cela en studio, je ne veux que les rappels, mais attention rapides et à 120m». Nous étions trois à descendre, Pierre R…, Etienne L… et moi. Quel pied ! Jamais nous n’aurions pu faire cet entraînement sur Paris sans Verneuil. Merci ! Pour nous ce fut une grande jouissance : la capitale à nos pieds, une vedette sympathique comme partenaire et les grands moyens. Potentiel aérien illimité, cordes neuves, etc… Le temps était couvert et la lumière sinistre. Notre équipage «les rois du stationnaire» (3) sur trois rotations nous permit «le carreau» à chaque fois. Les images furent superbes, mais l’émotion des Parisiens également. Arrivés en bas de la tour en rappel (c’était plus rapide que l’ascenseur), après la deuxième dépose, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, toutes sirènes hurlantes, trois SAMU et une Police Secours. Ils avaient reçu plusieurs appels angoissés de Parisiens leur affirmant que trois hommes étaient tombés d’un hélicoptère. De ce moment, il nous reste le souvenir d’une grève des figurants (à 40 francs par jour, la Gendarmerie cassait les prix), plus d’un kilomètre de «rush» que Verneuil nous a offert et une apparition de deux minutes dans un film d’une heure quarante ! Le début de la Gloire !
L’ÉVOLUTION TECHNIQUE : PETITE POUDRE ET GRANDS EFFETS…
Ce fut l’époque la plus créatrice. Chaque situation imaginée, l’expérience manquant, apportait son lot d’idées plus ou moins utiles. Les moyens n’étaient pas à la hauteur des besoins et il fallait harceler la hiérarchie pour obtenir les dotations nécessaires. Ce qui aujourd’hui paraît banal dans l’équipement est le résultat de plusieurs années de patience, pour convaincre les autorités, de l’utilité de certains matériels. Ce fut le cas des intensificateurs de brillance (appareil pour voir la nuit) qui, sous leur première forme, s’appelaient les startrons. Cette électronique, excessivement chère, modifiera considérablement la notion d’intervention, car elle permettra de rendre possibles les opérations de nuit.
Nous avons été les victimes indirectes de James Bond ! C’est assez surprenant, mais dans cette course à l’évolution technique, nous étions toujours en retard par rapport à la fiction. A une époque où l’on sait marcher sur la lune, comment expliquer qu’il n’existe pas de gaz incolore, inodore et sans saveur, capable d’endormir tout le monde en une fraction de seconde ? Cette arme absolue, beaucoup sont toujours persuadés qu’elle existe ; d’ailleurs qui n’a pas vu un film ou un feuilleton TV où elle est utilisée ! Je ne citerai que Daktari. Pour ceux qui n’ont pas connu, cela se passait en Afrique à grand renfort d’animaux sauvages, d’images de brousse et de seringues hypodermiques. «Mon Lieutenant, vous n’avez pas vu Daktari ? Pourquoi n’utilisez-vous pas les mêmes fusils, ceux qui permettent d’endormir les animaux !» J’en étais arrivé à devancer la question, car elle m’était posée systématiquement. Mis à part les dangers cardiaques, ce produit met un «certain temps» pour agir : au moins dix minutes dans le meilleur des cas. De plus, si endormir artificiellement les gens était si facile, la profession de médecin anesthésiste ré-animateur serait en sérieuse difficulté, ce qui n’est pas le cas, loin s’en faut.
Nous avions découvert certains effets du gaz lacrymogène, en particulier en espace confiné. Sans que l’on puisse savoir pourquoi, il nous semblait que le résultat devait dépasser les seuls effets lacrymogènes, en déséquilibrant le réflexe respiratoire. C’était sans aucun doute un problème de concentration, mais comment le modifier ? La Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.), avec laquelle nous développerons des moyens révolutionnaires, nous confirma nos hypothèses. Le CB, ïaz obtenu en maintien de l’ordre par combustion, atteint des taux ridicules de 4 à 7%… Pour concentrer le produit et éviter le temps de combustion, afin que les effets soient instantanés, il fallait changer la manière de diffuser. Le produit de base est une poudre blanche. Une erreur de manipulation du laboratoire avait permis une expérimentation involontaire, qui fut qualifiée par ses victimes de terrible. Les animaux, en particulier les chiens, ne sont pas sensibles au CB. Il nous fallait donc jouer les cobayes.
L’expérience de l’efficacité de la poudre de CB, que nous avions voulu prudente avec Pierre R… (il sera longtemps responsable des matériels) devint, à cause d’une bourrasque qui dispersa les cent grammes, la preuve insupportable de ce que nous pensions. Étendus dans l’herbe, suffoquant sous l’effet du CB. il nous fallut plus d’une demi-heure pour récupérer. Ce moyen terriblement efficace, créant une «angoisse respiratoire instantanée», nous apportait le moyen incapacitant, à défaut du «az soporiphique, dont nous avions besoin. Conditionnée avec des propulseurs à air comprimé, dont la mise au point fut particulièrement délicate, cette poudre nous permettra de résoudre un grand nombre de prises d’otages et d’arrestations difficiles.
Il y eut aussi un certain nombre d’erreurs, la recherche étant systématique. J’étais obsédé par la partie la plus difficile de l’opération, le moment où les hommes sont au contact. Les protections anti-balles de l’époque avaient une ressemblance avec les équipements de la guerre de cent ans… Très lourds et encombrants, ils étaient certes à l’épreuve des balles, mais transformaient le personnel en robots patauds, réduisant considérablement leur efficacité. Aussi, jusqu’à ce qu’apparaisse le kevlar (fibre souple et légère, capable d’arrêter presque tous les projectiles tirés par des armes de poing), les hommes interviendront en opération sans protection… Ces années à côtoyer la mort sans filet ont été les plus dures pour moi, conscient des risques que je’ devais faire courir à l’unité. Pourtant, lorsque les gilets en fibre, testés dans toutes les conditions, équipèrent le Groupe, le plus gros problème fut d’obliger les hommes à le mettre.
Toutes les excuses étaient bonnes : «c’est trop lourd, là où je suis je n’en ai pas besoin, etc…» Sur une opération particulièrement éprouvante, j’ai du obliger un «ancien» à le porter : Gérard B…, venu de Mont de Marsan, très efficace, qui prit comme une insulte cet ordre. Il reçut une demi heure plus tard une décharge de chevrotines à quatre mètres en pleine poitrine et en conservera la trace imprimée sur la peau plusieurs mois. Il eut beaucoup de mal à surmonter cette blessure, qui fut plus psychologique que physique. Le Général Raynaud, auquel nous devons d’être devenus parachutistes, me racontait qu’il avait connu ce genre de difficultés aux S.A.S. C’était l’époque de la création du premier régiment français aéroporté pendant la seconde guerre mondiale. Ils utilisaient un seul parachute et lorsque les Américains imposèrent le ventral (deuxième parachute en secours), ils refusèrent au début de s’en équiper, considérant ce moyen de sauvetage comme une injure à leur courage.
Nous savions que nous devrions, avant d’être au contact, nous heurter aux obstacles dressés pour nous empêcher de progresser: portes barricadées en particulier. La plupart des habitations ont des issues renforcées voire blindées, ce qui n’était pas pour simplifier notre problème. Aussi, avons-nous énormément travaillé sur les explosifs, pour en maîtriser les effets. Le plastique, avant que la S.N.P.E. nous fabrique l’explosif adhésif, que nous lui avions demandé, fut notre préféré. Nous étions capables de casser une serrure, un gond, découper un trou d’un diamètre bien précis, piéger une voiture pour que l’onde de choc «sonne» les occupants, etc… Un jour, le responsable du mess voulut mettre un vasistas d’aération dans la cave du bâtiment. Les murs étaient épais en «béton vibré». Après deux jours à secouer les malheureux gendarmes désignés, le marteau piqueur rendit l’âme et le mur était pratiquement intact. Craignant que l’engin fut remis en route, le bruit étant devenu insupportable, je décidai d’employer les grands moyens. Nous avons découpé le trou à l’explosif en moins d’une heure : il faisait 50cm sur 30 pour un mur de 40. Notre réputation de fous était déjà faite dans le quartier, mais là elle était confirmée.
Pourtant, ce n’était rien à côté de ce dont nous étions capables. On nous promettait depuis longtemps l’agrandissement de notre local à matériel, à l’intérieur duquel il y avait la salle d’alerte, une sorte de salon douillet en bois où nous attendions les départs, lorsqu’il y avait alerte, et surtout fêtions tout ce qui pouvait l’être. En forme de boutade, un de mes amis disait que le G.I.G.N. était l’unité, qui tirait le plus de munitions au monde et…, de bouchons de Champagne. J’avais convaincu le Colonel que les «stockeurs» (dans notre jargon, les responsables du service des matériels) avaient trop de place. Avec beaucoup de difficultés, à grand renfort de calculs sur les plans, il l’avait admis mais rien ne bougeait et le mur de séparation, qui devait être déplacé un mois après la décision, toujours en place. Excédé, je pris du plastique et découpais un trou de deux mètres dans la cloison en parpaings. Ce fut la panique dans le bâtiment (tout cela se passait au sous-sol), qui logeait les services techniques. Les plombs avaient sauté et l’on vit sortir hébété le responsable des transmissions, qui se trouvait au-dessus du local, répétant sans arrêt : «je l’avais bien dit qu’ils feraient tout sauter. Je l’avais bien dit…» Le mur entamé, le magasin eut enfin des dimensions raisonnables.
Le Président de la République reçu par le Préfet Prouteau lors de la visite officielle au P.C de sécurité des J.O.
LA VIE D’ALERTE !
Tout ce qui pouvait concourir à une meilleure efficacité du Groupe était exploité. Systématiquement, nous prenions contact avec les sociétés pour que les matériels nous soient présentés et devancions le service central du matériel, qui ne comprenait pas toujours que le processus soit inversé. Le G.I.G.N. avait un besoin tout à fait spécifique et les équipements des unités traditionnelles ne pouvaient nous convenir, que ce soit l’habillement ou la radio. Par contre, nous testions tous les moyens qui pouvaient être une extension de nos sens, comme le matériel d’écoute murale ou l’endoscopie (4). C’est pendant cette période que nous avons commencé à travailler avec les chiens, auxiliaires précieux, qui ont beaucoup compté dans cette aventure. Celui qui nous a le plus marqués est le premier : Krex.
Deux des chiens d’attaque du GIGN: berger allemand Arno et Rottweiller Jary
Lorsque j’ai demandé un chien d’attaque, ce fut un beau tollé : le chien en Gendarmerie étant à l’époque ou de garde ou surtout pisteur. Nous, nous en souhaitions un capable de désarmer un homme ou de le situer rapidement dans un grand espace. Gramat, le centre canin de la Gendarmerie, accueillit Daniel D… avec méfiance et ils lui donnèrent un chien ayant mauvaise réputation, dont personne ne voulait. Un de ces caractères qui, transposé aux hommes, convenait parfaitement au G.I.G.N. : indépendant, forte tête, courageux, résistant. Il y eut beaucoup de chiens au Groupe, mais celui qui a compté le plus fut Krex. Il était beau et intelligent. Alors que certains instructeurs de Gramat étaient persuadés que Daniel D… n’aboutirait à rien avec ce berger allemand, ce fut un succès. Le chien adopta tout de suite son nouveau maître et, alors qu’il avait toujours posé des problèmes, comprit rapidement ce que l’on attendait de lui. Comme les dix-sept premiers hommes ont ouvert la technique G.I.G.N., Krex ouvrit celle des chiens du Groupe. Il était capable de sentir la différence entre un départ d’entraînement et un départ d’intervention où, en dehors de sa fébrilité, aucun jappement ne dévoilait notre présence.
L’alerte, pendant des années, dévora notre vie… La sonnerie était à la fois attendue et redoutée. Le découpage de l’Unité fut tout de suite ternaire. Nous avions trois équipes d’intervention à cinq, mon adjoint et moi. Comme cet effectif n’était pas suffisant, l’équipe d’alerte, qui devait être prête à partir en moins d’une demi-heure pendant une semaine, était soutenue par la deuxième, le personnel ne devant pas s’éloigner pendant plus de deux heures de la caserne. Cette astreinte dura plusieurs années et la vraie difficulté fut surtout pour moi de choisir une équipe devant rester en réserve et tous les hommes se présentant lorsqu’il y avait une alerte… La structure en équipes se divisait en deux binômes et un chef. Les trois premiers chefs furent : Ignace W…, René T… et Roger M…
Cette notion de binôme est fondamentale au Groupe, l’action de contact se faisant toujours par deux : un en progression, un en protection, responsabilisant les hommes au-delà de la mission, mais aussi et surtout à travers l’amitié. Lorsque le G.I.G.N. s’étoffera, les équipes seront transformées en groupes de trois, quatre puis cinq binômes, etc… et le système ternaire sera conservé. C’est après Djibouti que la Gendarmerie prit véritablement conscience de l’intérêt du G.I.G.N. L’effort consenti fut important et le temps du pistolet à plomb terminé. Plus rien ne pouvait être comme avant ; c’était heureux pour l’avenir du Groupe, mais ce chapitre de notre histoire était terminé et il marquera nos cœurs.
Les premiers changements furent au niveau du chef que, malgré la présence de Claude Lepouzé, le Directeur, Monsieur Cochard, trouvait un peu seul. C’est plus par raison que par envie que j’acceptais de tester deux officiers, que l’on me proposait pour me seconder : Alain Le Caro et Paul Barril. Nous étions au mois de juin 1976. Il était difficile de faire un choix, les deux étant particulièrement brillants dans leurs résultats. Je me décidais pour Paul Barril, qui était moins ancien en grade qu’Alain Le Caro et six mois après, Paul, étant «opérationnel», une nouvelle page du G.I.G.N. était tournée et sa personnalité allait compter pour le Groupe. Alain Le Caro, durant toutes ces années, fut auprès de nous dans les bons et mauvais moments de la vie de l’unité. Je lui avais dit qu’un jour nous travaillerions ensemble et quelques années plus tard, je l’appelais pour commander le Groupe de Sécurité de la Présidence de République (G.S.P.R.).
DE LA JOIE A LA PEINE…
Après chaque intervention, une tradition s’établit rapidement : se retrouver autour d’une table. Une manière comme une autre de manifester notre joie d’avoir réussi. Notre retour de Djibouti fut un bon exemple. Le Gouvernement pensait que les familles des militaires, stationnées dans cette région, souhaiteraient rentrer rapidement et avait envoyé un Boeing 747 d’Air France, pour les rapatrier. Le calme étant revenu, personne ne voulut revenir et le G.I.G.N. fut pratiquement seul dans cet avion de près de quatre cents places. Nous fûmes choyés par l’équipage et le Commandant de bord nous fit, au moment du décollage, un long discours technique sur les capacités du 747, histoire sans doute de nous faire remarquer que neuf passagers, fussent-ils G.I.G.N., ne pesaient pas lourd…
Le plaisir d’avoir gagné ne nous faisait pas oublier l’essentiel : être meilleurs la fois suivante . Chaque opération était après coup étudiée, décortiquée pour apprendre le plus possible et faire évoluer notre technique d’intervention. Nous savions qu’il faudrait repartir et à nouveau réussir face à un problème différent, au risque d’être jugés sans égard, quels que soient les résultats passés. Une remise en cause systématique qui, après une centaine d’interventions réussies et plus de cinq cents otages libérés, laisse une impression désagréable d’injustice (5). C’est d’autant plus dur que le tribut, qu’il a fallu payer, a été lourd.
Épargnés pendant les premières années, nous avons réalisé douloureusement le prix du succès. Le niveau de l’entraînement est à la hauteur de la mission et les risques pris étudiés. Pourtant, le destin nous a frappés, alors que nous ne le méritions pas. Un troc sinistre et injuste, que je savais ne pas être capable de supporter longtemps : Raymond, Henry, Jean-Louis nous ont quittés. J’annonçais à mes hommes que, pour moi, c’était trop. Après neuf ans où j’ai eu l’honneur de les commander, je pris la décision d’arrêter. La vie m’apporta le moyen de continuer à les aider et je pus créer le Groupement de Sécurité et d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (G.S.I.G.N.) en décembre 1983. Mais, pour moi, la page était tournée. Depuis, la liste s’est allongée : Patrick et Michel ont disparu.. Des années après être parti, ce que je ressens n’a pas changé…
Ce que le G.I.G.N. a fait pendant ces dix-sept ans était indispensable. Des premiers, il ne reste plus personne au Groupe, mais la relève est assurée. Les Titi, Dudu, Pierrot, Nanar, Nono, Charley, Jeannot, etc… ont tracé la route. Ces quelques pages étaient pour eux, les dix-sept et les autres, sans lesquels rien de tout cela n’aurait pu arriver.
Dix-sept ans après, Paris, le 9 novembre 1990
«LE GRAND»
(1) Assurance : moyens permettant de sauver celui qui fait l’exercice en cas de chute. (2) Il fera en particulier un document d’instruction sur les sports de combat, qu’il souhaitait voir devenir une référence de formation qui, malheureusement, restera aux archives. (3) A 120 m du point de dépose, soit 220 m du sol, les repères pour l’équipage avec le vent et l’altitude sont inexistants. Seul, leur professionnalisme nous assurait une dépose sur le toit et non pas dans le vide. (4) Endoscope : fibre optique permettant de voir à travers une serrure par exemple. (5) Pour les interventions du G.I.G.N., se reporter à l’excellent livre de Jean-Claude Bourret : «G.I.G.N. – Les exploits des gendarmes anti-terroristes (NDLR) chez France Empire.





![[GIGN] Le GIGN va évoluer, mais restera « l’ultima ratio » Schéma national d'intervention Exercice Montparnasse - GIGN](https://www.gign-historique.com/wp-content/uploads/2019/10/2016MINT0281_009-218x150.jpg)
![[AGIGN] Les six antennes GIGN de métropole se musclent AGIGN Nouvelle Calédonie 2018](https://www.gign-historique.com/wp-content/uploads/2019/10/D4S8965-218x150.jpg)

![[Antenne GIGN] La force de frappe (2016)](https://www.gign-historique.com/wp-content/uploads/2016/12/201611_Genf-info_num391_Antenne-GIGN_Antilles-218x150.jpg)











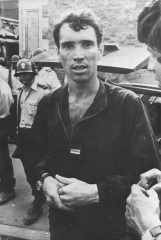











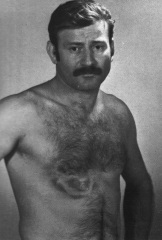







![Uniformisation des tenues d’intervention MININT [GIGN]](https://www.gign-historique.com/wp-content/uploads/2018/06/2018_nouvelles_tenues_combat_GIGN_MININT_bleu_vert_gris-100x70.jpg)